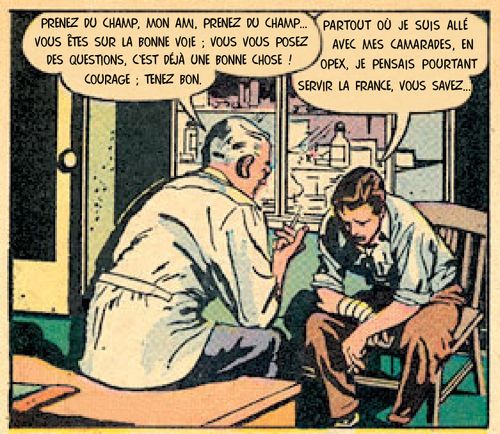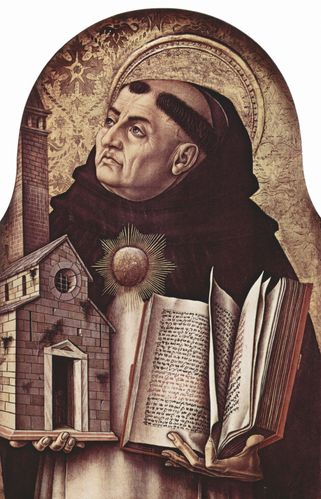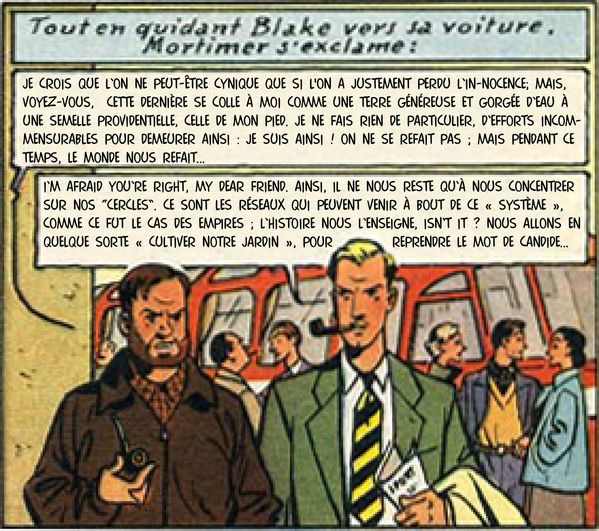Polis tis koinônia
Eric Werner commence par une délimitation du champ d’action du politiste ; pour ce faire, il tente de définir ce qu’est la Cité. C’est en cheminant avec Aristote et Platon, et plus particulièrement avec La Politique et de La République, que s’élabore la recherche. Werner oppose le premier au second en montrant comment et où Platon fait erreur.
La Cité serait donc une « sorte de communauté » où l’autorité s’exerce d’une certaine façon, en fonction du système politique existant. Werner passe en revue les différents types d’organisation de la Cité et du système d’autorité depuis sa forme idéale jusqu’à sa forme dégénérée. L’auteur insiste sur le principe d’autorité et montre en quoi les analogies platoniciennes sont fausses ; puis, il nous conduit vers ce qu’il considère comme la définition la plus arrêtée de la Cité : « une sorte de communauté composée d’hommes semblables, libres et égaux ».
Enfin Werner cherche, avec Aristote toujours, le meilleur des systèmes de gouvernement ; ceci en ayant distingué au préalable les constitutions correctes des incorrectes par l’attitude des gouvernants à l’égard du bien commun. Il s’en dégage de ce premier chapitre, par un souci de « réalisme », la préférence d’un système parmi les trois corrects : le « gouvernement de la multitude » qui s’incarne dans la république (Politeia).
Aristote critique de La République
En préambule, Werner établit la distinction essentielle entre la politique et la métaphysique ; distinction qui fait encore s’opposer Platon et Aristote. Si Platon tend à subordonner la politique à la métaphysique, Aristote donne l’autonomie au second par rapport au premier. Il en découle des prospectives politiques radicalement différentes.
En analysant les deux conceptions, Werner suit Aristote pour finalement convenir, contre Platon, que « la Cité est par nature une pluralité » car c’est en cela qu’elle acquiert une autonomie (autarkeia). L’auteur reproche plus loin à Platon son assimilation du plan politique et du plan érotique (Le Banquet), et donc qualifie sa politique de « contre-nature ».
Reprenant Aristote et son Ethique à Nicomaque, Werner montre que, dans la Cité, les liens entre citoyens se rapprochent plus du sentiment d’amitié que de celui d’amour (comme avec Platon). Il montre aussi que la vertu ne peut être le fondement de la Cité par le fait qu’elle deviendrait alors totalité ; c’est l’utilité qui est le fondement, la raison d’être de la Cité.
Élargissant la perspective, l’auteur, prenant pour appui la livre VI de l’Ethique à Nicomaque, met en lumière l’intérêt que les qualités de sagesse et de prudence peuvent avoir dans leur rapport à l’utile. La prudence étant discernement de l’utile et la sagesse sans rapport avec lui, la première qualité est donc plus recommandable pour l’homme d’action, pour l’acteur dans le politikos. Tant dans le cadre de la Polis que dans celui du Politikos, la référence à l’utile est caractérisée.
Avec le livre IV de l’Ethique, revient l’opposition entre Aristote et Platon, cette fois avec la distinction entre communauté politique et communauté éthique. Par là même, la vertu ne peut plus être le fondement de l’amitié ou du moins du lien existant entre citoyens, mais bien plutôt l’utilité.
Poursuivant avec Le Banquet, Werner met en évidence l’opposition entre la vision politique d’Aristote et celle de Platon. L’amour rassembleur platonicien (sunagôgeus) ne se résolvant que par une contemplation de soi-même, une contemplation pure, ne peut plus être instrument ou élément du législateur.
Ainsi, le fondement de la Polis sur l’amour n’est plus qu’un idéal apolitique. Aristote convient de l’importance de l’éthique et donc de la vertu mais, prévenant tout absolutisme, il instaure l’irréductibilité de la sphère politique. Si les sphères politique et éthique existent en toute indépendance, la politique trouve néanmoins sa limite dans l’éthique.
Machiavel et le mythe de la réforme
Werner utilise Le Prince pour cerner ce qui doit être le rôle et la qualité du pouvoir de celui qui gouverne. Des conflits avec les règles éthiques peuvent survenir dans l’exercice du pouvoir du Prince mais il n’en demeure pas moins qu’en temps normal, rien ne le dispense de s’y conformer. Quand la survie de l’État est en jeu, le prince doit passer outre ces règles ; demeure néanmoins la distinction faite entre violence restauratrice et violence qui ruine. Machiavel n’éludant pas pour autant le rôle que joue la notion de bien commun même s’il ne l’aborde que succinctement.
Plus loin, le Prince est défini comme celui « qui donne forme » aux hommes qui composent la Cité, ceci pour un seul but : la défense contre les barbares. Le Prince « travaille » donc l’homme comme un sculpteur travaille la matière pour faire apparaître son objet. Mais, contrairement à Platon, chez Machiavel la Cité n’est pas un fait de nature, et la forme ne se dégage pas de la matière ; le Prince introduit cette matière.
Il y a pourtant quelques analogies qui pourraient être faites avec Platon, notamment entre le modèle sur lequel est conçu le prince machiavélien et celui sur lequel est conçu le roi-philosophe. Les deux modèles tirent en effet leur autorité du démiurge dont ils prolongent l’action.
Le thème très important de la virtù est ce qui donne le trait volontariste du Prince ; ainsi, grâce à la virtù, ce n’est plus l’histoire qui fait l’homme mais l’inverse. Quand Machiavel refuse au Prince l’action violente, sanglante lorsque les fins ne la justifie pas, c’est que ce qu’il faut « conquêter » c’est l’honneur et non le gain de quelques seigneuries.
Werner confronte plus avant Descartes et Machiavel. Ce qui les distingue, nous dit-il, c’est l’importance qu’ils donnent l’un et l’autre à l’histoire. Pour l’auteur de la Méthode, l’histoire est maîtresse d’erreurs et ne se distingue en rien des œuvres de fiction , alors que pour Machiavel l’histoire est école, sinon l’école ; et quand bien même l’histoire ne serait que fiction, les personnages dont elle exalte les hauts faits ne cessent d’être des modèles.
Soulignant le génie de Machiavel, Werner insiste et achève son chapitre sur le fait que le Prince n’est pas celui qui contraint mais celui qui construit dans la perspective d’une histoire à faire.
Mystique et politique
C’est avec Rousseau qu'Eric Werner nous convie à la réflexion dans ce chapitre. La nouvelle Héloïse révélant bien des aspects ayant trait à la Cité et des rapports entre les sujets de celle-ci. Pour Rousseau la Cité est un « corps moral et collectif », produit de l’assujettissement à la volonté générale. Cet assujettissement est la condition sine qua non de l’existence même de la Cité. Le citoyen est l’individu qui s’est nié comme individu. Une convergence s’opère entre le Platon de La République et Rousseau sur le fait que l’État le mieux gouverné est celui qui se rapproche le plus du modèle de l’individu. La vrai famille, la grande famille est la Cité.
Cependant, une divergence existe entre les deux auteurs ; contrairement à Platon, Rousseau n’est pas pour un anéantissement de la famille dans l’État. La famille doit être maintenue car assimilant le lien civique au lien familial, Rousseau considère que supprimer la famille serait saper les bases mêmes de l’État.
Pour Karl Popper, nous dit Werner, la Cité platonicienne est cité « close » ; celle-ci, livrée à l’anarchie, se délite et se perd. Il faut donc la retrouver ; de là naît la nostalgie de la cité d’origine, de la Cité perdue. Werner voit dans Le Banquet une préfiguration de La République dans ce que l’on peut y trouver comme extension au plan politique de la mystique fusionnelle triomphant dans l’amour. Pourtant le modèle platonicien de la Cité serait plutôt celui de l’Académie, où la Cité est communauté éthique ; la vertu ayant été le but de l’éducation du maître.
Rousseau est également un défenseur de la « cité close » ; à Athènes, il préfère Sparte. Cependant, dans son Discours sur les sciences et les arts, Rousseau part dans des développements et des choix que récuse Platon. C’est en laissant apparaître une tendance marquée à assimiler la vertu aux qualités guerrières, que Rousseau s’éloigne de Platon.
Et Werner de nous fait remarquer plus loin l’opposition entre les Encyclopédistes et l’auteur de l’Émile : ceux-là sont partisans d’une cité ouverte, contrairement à celui-ci. Plus avant, l’auteur souligne les divergences notables entre Rousseau et « les philosophes » : si pour celui-là, le problème moral reste en première place dans ses préoccupations, pour ceux-ci, la raison d’être de l’État est la satisfaction des besoins matériels des individus. Pour Rousseau, ce n’est pas le bien-être que doit réaliser l’État, mais la vertu.
Reprenant Aristote et son Éthique à Nicomaque, Werner nous rappelle les trois fondements de l’amitié qui sont l’utilité, le plaisir et la vertu. Nous est rappelé également ce qui constitue le fondement, la raison d’être de la Cité : l’utilité commune et non la vertu.
Revenant à Rousseau, et cette fois avec le Contrat social, Werner relève le ton et le contenu « quasi mystique » de l’ouvrage. Dans cet essai, Rousseau énonce que le citoyen n’est réellement citoyen que s’il s’identifie à la raison ; il n’y a, là, plus de distinction entre le problème politique et le problème moral. La solution du problème moral est presque condition de la solution du problème politique ; en conséquence, il n’y a qu’une seule voie possible : l’homme doit changer intérieurement. Toutefois, Rousseau n’utilise pas uniquement la raison mais la volonté générale comme pierre d’achoppement ; la volonté générale se confondant avec l’essence rationnelle de l’homme.
Werner dément la parenté que Ernst Cassirer établie entre Rousseau et Kant dans The question of Jean-Jacques Rousseau. En effet, dans les rapports entre politique et morale, si la perspective kantienne est dualiste, celle de Rousseau est moniste ; Kant délimitant, contrairement à Rousseau, le domaine politique par rapport au domaine moral. De plus, Kant apparaît comme un défenseur d’une société ouverte, et ce qui est chez Rousseau politique, est chez Kant éthique. Si Rousseau moralise les concepts politiques, Kant dépolitise les concepts éthiques.
Werner reprend le parallèle entre Aristote et Rousseau, et note que la communauté de Clarens est l’exacte réplique de l’idéal aristotélicien. La belle âme de Rousseau ne serait rien d’autre que l’âme vertueuse d’Aristote.
Concluant provisoirement, Werner convient du fait que Clarens n’est pas Polis mais oikia, même si chez Rousseau la frontière entre les deux est flottante. Il s’ensuit de ce constat que si la politique rousseauiste s’enracine dans la mystique, cette mystique porte tout de même en elle les germes d’une politique.
Polémique
Nous restons toujours avec Rousseau et le Contrat social, et avec Aristote et sa Politique. Werner fait tout d’abord surgir une opposition formelle dans l’analogie rousseauiste entre les façons de gouverner une cité, commander des esclaves ou des enfants, et ce qu’Aristote déclare dans son livre I. Il résulte de cette opposition que si le pouvoir paternel et le pouvoir despotique ont un caractère absolu, ces pouvoirs s’opposent tout de même par leurs fins respectives ; si l’esclave est moyen, l’enfant, lui, est fin.
Werner traite ensuite des divergences existantes entre un Rousseau et un Aristote sur la question du monarque et de la monarchie, de leurs relations et analogies avec le pouvoir paternel, d’une part, et le pouvoir du maître d’esclaves d’autre part. Si pour Rousseau le monarque est tyran par essence et donc la monarchie tyrannie, pour Aristote, il existe une monarchie « correcte » bien distincte de la tyrannie. Enfin, si pour Rousseau, l’histoire fait l’homme esclave et non la nature, dans la Cité aristotélicienne, seuls les maîtres sont citoyens, et s’ils sont maîtres c’est par nature. Pour Aristote, certains hommes naissant pour l’esclavage et d’autres pour la domination.

« Nul n’est injuste envers lui-même »
Werner, tout en montrant la continuité de Rousseau par rapport aux penseurs libéraux (Locke et Montesquieu), n’en dénote pas moins des divergences. Si, tant dans l’Essai sur le Gouvernement civil que dans l’Esprit des Lois, tout absolutisme est un mal, pour Rousseau il n’est de mal que l’absolutisme monarchique ; ce qu’il faut, nous dit Rousseau, c’est substituer l’absolutisme d’un seul à l’absolutisme de tous, le pouvoir absolu entre les mains de tous cesse d’être un mal. Ce qu’il faut, trouvons nous toujours dans Le Contrat social, c’est une refonte nécessaire de l’homme pour qu’à l’état de nature se substitue l’état civil, pour que l’individu s’aliène à la communauté. Rousseau précisant que c’est à l’intérêt bien compris de l’individu qu’il faut faire appel pour opérer à bien cette transformation.
Du législateur
Werner reste avec Rousseau et Le Contrat social pour aborder la question centrale du Législateur. Tout d’abord, traitant de la liberté et de l’esclavage, nous voyons que l’objet de Rousseau n’est pas la restauration de la liberté, mais la substitution d’une forme « légitime » d’esclavage à une forme « illégitime ».
Qu’est donc le Législateur ? Il s’identifie au sage, dispensateur du vrai. Devant lui, le peuple est une sorte d’enfant qui répugne aux abstractions. Le Législateur agira envers le peuple comme le précepteur de L’Emile à son élève ; il s’adressera non moins à la raison qu’à l’imagination. Le Législateur s’emploiera même à faire parler les dieux.
Quelles sont les tâches du Législateur ? Il est celui qui fait voir, celui qui institue. Le Législateur, nous dit Rousseau, doit changer la nature humaine pour instituer un peuple.
Quant au peuple, soit il n’est pas encore institué, et alors il s’agira de l’instituer ; soit, il est déjà institué, alors il s’agira de l’éclairer. Se précise ainsi le rôle du Législateur comme pivot du système politique de Rousseau.
Werner fait ensuite une analogie entre le Léviathan de Hobbes et Rousseau sur leur conception respective du pacte social. Si chez Hobbes, chacun se donne tout entier au Prince, chez Rousseau chacun se donne tout entier à la communauté. Avec le pacte rousseauiste, ce n’est plus la communauté qui apparaît comme le bénéficiaire de l’acte d’aliénation, mais la volonté générale. Le pacte ainsi entendu, est simultanément de sujétion et d’association.
Nous voyons dans le Léviathan que ce n’est pas le corps politique qui engendre le souverain, mais bien le souverain qui engendre le corps politique. La souveraineté chez Hobbes se trouve être l’âme de la République ; et de même que Dieu a produit l’homme naturel, l’homme lui-même produit la République. Rousseau, tout comme Hobbes, oppose l’état de nature à l’état social ; ainsi le lien social aura-t-il un caractère non pas naturel mais artificiel.
Pour Hobbes, héritier du nominalisme, le Prince joue le rôle du tertium quid. Le pacte hobbien est celui de chacun avec chacun, et la renonciation de l’individu à ses droits se fait au bénéfice du seul Prince. Au Prince se substituera chez Rousseau la volonté générale. Cette volonté générale ne pouvant par elle-même agir, elle agira par le truchement d’un organe médiateur : le Législateur. Werner établit enfin que le pacte rousseauiste dérive du pacte hobbien ; dans les deux cas, tout s’ordonne autour de l’idée d’aliénation.
C’est Machiavel, nous dit Werner, qui laisse la marque la plus importante dans le chapitre de Rousseau sur le Législateur. Tant comme guide que comme façonnateur, le Législateur rousseauiste est d’essence machiavelienne.
La fin de ce chapitre est une petite estocade de Werner à Rousseau. Aboutissant au fait que le système rousseauiste est une utopie, et que le Législateur est une figure de rêve, Werner définit la politique de Rousseau comme « tout entière rêve ». Rousseau faisant appel aux dieux en dernier recours, que faire nous dit Werner, si les dieux refusent de se faire Législateurs ? Et l’auteur de constater que Rousseau reste muet sur ce point.
Brièvement, Werner nous traite de l’influence du Contrat Social sur la Révolution française ; cette influence est, dit-il, grandement exagérée par le simple fait que ce n’est qu’après 1793 que Rousseau a été réellement lu. Et enfin, ajoute-t-il, tout réside bien sûr dans l’interprétation qu’on se fera de la Révolution française.
Du désir de fusion
Reprenant les critiques rousseauistes, Werner en arrive à dire paradoxalement que, loin de rompre avec la pensée monarchique, l’auteur de L’Emile non seulement confère à celui-ci un nouvel élan, mais encore fait récupérer à l’absolutisme monarchique sa jeunesse. Toujours selon Werner, ce serait commettre erreur que de dissocier chez Rousseau le thème mystique du thème absolutiste.
L’auteur se permet ensuite un rapprochement d’avec Sartre. L’œuvre de Sartre, nous dit-il, se constitue sur le même schéma que l’œuvre de Rousseau. Ce sont les valeurs érotiques qui servent d’étalon de mesure dans l’appréciation portée sur les diverses formes de vie politique. Werner poursuit la lecture de Sartre en n’omettant pas que dans sa Critique de la raison politique, son auteur n’hésitera pas à conclure son analyse par un plaidoyer en règle en faveur du stalinisme.
Les lectures comparée de Rousseau et de Sartre font pourtant apparaître des divergences. Si un rôle fondamental est donné par les deux auteurs au tertium quid, c’est dans dans la façon dont ils conçoivent la mission du tiers qu’ils s’opposeront. Alors que pour Rousseau, le tiers se définit d’abord comme un éducateur, pour Sartre il se définit d’abord comme un gendarme. Pour Rousseau, il s’agit de transformer de l’intérieur l’individu. Ce qui oppose les deux auteurs, c’est aussi leurs conceptions respectives du pouvoir, et plus encore, deux conceptions de l’homme : la conception rousseauiste est optimiste puisque l’homme est éducable, et la conception sartrienne est pessimiste puisque ce n’est qu’en lui faisant peur qu’on arrive à ses fins.
Pour autant, les œuvres de Sartre et celle de Rousseau obéissent à la même logique. Ce n’est que dans la mesure où nous nous assujettissons à un tiers que nous parviendrons à l’unité. Werner s’interroge cependant sur le fait de savoir si ce qu’il y a de meilleur pour la Cité est bien l’unité la plus parfaite possible.
Werner souligne l’importance que revêt dans la politique rousseauiste la mystique fusionnelle, et le fait que cette politique n’est pas une politique de la liberté mais celle de la totalité ; il souligne également que la valeur sur laquelle s’articule l’ensemble du système rousseauiste n’est pas la liberté mais l’amour. Enfin, s’appuyant sur le livre d’Ernst Cassirer, Le Mythe de l’Etat, Werner remarque que la politique rousseauiste est l’illustration même de la pensée mythique.
« Hors l’être existant par lui-même, il n’y a rien de plus beau que ce qui n’est pas »
Reprenant La nouvelle Héloïse, Werner note la prédilection de Rousseau pour l’asymétrie, et nous montre que les raisons de cette préférence sont d’ordre éthique. De plus, poursuit Werner, puisque « l’homme est né bon, et [que] c’est la société qui le corrompt », le mal n’est plus en l’homme mais hors de l’homme. Donc, c’est en réformant la civilisation, responsable première du mal affectant l’homme, c’est en agissant sur ce qui est hors de l’homme, que nous guérirons l’homme. Cet « hors de l’homme » n’est que le milieu sensible ; ainsi, agissant sur lui, en viendrons-nous un jour à ne plus nous détester nous-même. Il faut, si nous suivons Rousseau, verrouiller le milieu ; or, nous dit Werner, à l’expérience, l’explication se révèle fausse.
Pour Rousseau, la condition première du bonheur est la vertu (bien peu révolutionnaire, note Werner) ; et cette vertu n’est autre chose que ne pas chercher à se fuir soi-même. Si Rousseau oppose Paris à la communauté de Clarens , c’est que dans la capitale, l’homme apparaît comme en perpétuel état de manque.
Dans la dernière lettre de Julie, avant la disparition de cette dernière, nous apprenons que trop de bonheur n’est plus le bonheur , et même que celui-ci arrive à générer l’ennuie. Werner relève également l’importance du thème religieux de cette lettre. Si insatisfaction ou ennui il y a, c’est que l’homme aspire à l’infini. Dépassant le cadre de la Nouvelle Héloïse, Werner nous récapitule ce qui fait l’élément commun aux œuvres de Rousseau : il faut que l’homme s’en tienne aux bornes que lui assigne la nature, et à vouloir transgresser ces bornes, l’homme ne s’attire que des déconvenues.
C’est, cette fois, dans le chapitre terminal du Contrat Social, que Werner nous conduit. L’auteur y décrypte les rapports entre le spirituel et le temporel chez Rousseau. Ce dernier, cherchant un moyen terme entre la religion de l’homme et celle du citoyen, fait apparaître une lutte entre l’esprit païen et l’esprit chrétien, entre l’exigence de limite et l’aspiration à l’illimité. Prenant les figures de Socrate et de Caton, lesquels ont un rapport différent à la Cité, Werner note que Rousseau préfère Caton, « plus citoyen », à Socrate, « plus philosophe ». Mais, demande Werner - sans omettre de remarquer les contradictions internes - à qui donc s’apparente vraiment Rousseau, lui qui est dans le Contrat Social si critique à l’égard de la religion du citoyen, mais la préfère en définitive à la religion de l’homme ?

Explication de Soljénitsyne
Avec Soljénitsyne, Werner nous entraîne en un premier temps vers une définition du tyran. C’est bien sûr le tyran soviétique qui est caractérisé ; et Werner de mettre en parallèle les propos de Platon dans La République et ceux de Soljénitsyne dans L’Archipel du Goulag. Il nous montre comment le tyran ne peut exister sans la présence de traîtres, de scélérats. Dans le système soviétique, nous dit Soljénitsyne, ce ne sont pas les meilleurs qui exercent l’autorité, ce sont les pires ; les criminels occupent les premières places et les meilleurs sont en prison.
Approchant le système concentrationnaire soviétique, nous voyons grâce à Soljénitsyne comment une personne peut être en mesure d’y survivre et les conditions de cette survie. C’est tout d’abord un dilemme : perdre la vie ou la conscience, tout est dans ce choix ; survivent ceux qui plient. Faire de la vie la valeur suprême, c’est raisonner comme les traîtres ou les tyrans. Ce conflit des âmes, Werner le met en parallèle avec le conflit qui existe dans la cité elle-même ; une lutte entre le bien et le mal. Le point de vue de Soljénitsyne rejoint là encore celui de Platon ; la tyrannie est considérée comme une maladie de la cité mais, précise Werner, avant tout parce qu’elle est en premier lieu une maladie de l’âme. Pour les deux auteurs, l’âme tyrannique est l’âme bestiale ; ce qui caractérise l’homme tyrannique c’est le triomphe en l’homme de la bête.
Traitant de la condition de l’homme en univers carcéral, Werner montre le paradoxe qui fait que donnant l’occasion de « réfléchir », la prison offre la vraie liberté. Si un parallèle peut être fait entre Platon d’une part - qui dit que mieux vaut subir l’injustice que la commettre - et Soljénitsyne d’autre part, ce dernier va pourtant plus loin que le premier, en se posant la question de savoir si subir l’injustice n’est pas même en soi un mal.
Abordant d’autres ouvrages comme Le Pavillon des cancéreux dont le ressort premier est l’amour, et Le premier cercle qui s’organise autour du thème de l’amitié, Werner sonde l’approche empirique des rapports humains de Soljénitsyne. Toujours sur le problème du mal, une analogie apparaît entre Rousseau et l’auteur russe : pour éliminer le mal, il faut changer l’homme, et seule la religion peut opérer ce changement ou du moins endiguer le mal. La meilleure thérapie est donc d’ordre moral.
Dans la Lettre aux dirigeants de l’Union Soviétique, nous voyons l’équivoque et le paradoxe du discours au tyran ; révélant aux dirigeants soviétiques les voies par lesquels ils pourront échapper à la ruine, Soljénitsyne ne se range-t-il pas de leur côté ? Rappeler au(x) tyran(s) le sens de l’intérêt commun, c’est aussi, s’il(s) l’entend(ent), permettre au régime de perdurer. Pour se faire entendre malgré tout du tyran, le philosophe peut-il s’épargner de lui parler sa langue ? Le mode utilisé par Soljénitsyne lorsqu’il s’adresse aux dirigeants soviétiques est très comparable, nous dit Werner, à celui utilisé par Aristote lorsque celui-ci s’adresse au tyran.
Werner aborde enfin les rapports de Soljénitsyne avec l’Occident. Pour l’auteur russe, la crise morale que traverse l’Occident offre une grande similitude avec la situation dans laquelle se trouvait la Russie à la veille de la révolution. Le propos critique de Soljénitsyne montre que son auteur ne témoigne pas de beaucoup plus d’indulgence pour la démocratie américaine que Platon pour la démocratie athénienne. La conception soljénitsienne de la société est élitaire et privilégie l’ordre par rapport à la liberté, et c’est peut-être la raison pour laquelle son discours n’a pas été bien reçu pas les « biens pensants » occidentaux, et que l’exilé russe est devenu la mauvaise conscience de l’Occident libéral. Les prescriptions de Soljénitsyne sont tout d’abord des prescriptions de la conscience, nous dit Werner. La pire des maladies étant celles qui affectent l’âme, c’est à la préservation de la santé de l’âme que vise l’auteur de L’Archipel.
Post-Scriptum
Dans cet appendice, Werner tire profit des avertissements de Soljénitsyne, de son analyse de l’Occident libéral. Brièvement nous abordons la question de la liberté par rapport au libéralisme, puis du libéralisme par rapport au nationalisme, et la rupture survenue en 1914 dans l’alliance séculaire entre les valeurs libérales et l’État Nation ; puis nous survolons les années 30 qui entament, nous dit Werner, la rupture de la nation avec la liberté. Après 1945, l’État Nation recule face aux hégémonies des deux blocs. Enfin , Werner précise que ce n’est pas Marx qui permet de comprendre les révolutions du XXème siècle mais bien plutôt Machiavel.
Dans son diagnostic de la société des années 70 – date à laquelle l’auteur écrit son essai – Werner nous montre que l’erreur fondamentale du libéralisme est de se méprendre sur le système de valeur de son adversaire soviétique : ce n’est pas le bien-être que visent les dirigeants russes mais la puissance. Seuls deux discours, bien qu’ils soient marginaux, sont en prise sur le siècle, conclu-t-il : le discours traditionnel, contre-révolutionnaire d’une part et le discours gauchiste d’autre part; deux approches ayant en commun le fait de réhabiliter la réflexion politique.
Conclusion
Pour clore son essai, Werner traite du totalitarisme en reprenant la justesse d’analyse d’Hannah Arendt. Il montre que deux écoles débattent de cette question avec des approches différentes : l’école libérale et l’école traditionaliste. Pour la première, le totalitarisme est l’expression de la nostalgie de la société close, alors que pour la seconde, le totalitarisme est fils de la société ouverte, dont il ne fait qu’actualiser les virtualités latentes. Deux philosophies politiques donc, deux conceptions de l’homme et de la société.
L’interrogation sur le totalitarisme, nous dit enfin Werner, c’est l’interrogation sur l’Occident lui-même. Puis, ultime présupposé, il faut se garder que cette étude du totalitarisme ne devienne elle-même totalitaire.

⏩ Mystique et Politique, d'Eric Werner est édité aux éditions de l’Age d’Homme (1980).